|
|
Liaison, 14 octobre 2004
Chronique du 50e
Une quête constante de rayonnement
ROBIN RENAUD
Au début des années 1960, la plus jeune université québécoise doit
faire preuve d'ambition pour se tailler une place aux côtés de ses
rivales. Il faut d'abord qu'elle se fasse connaître dans la grande région
de l'Estrie, mais aussi auprès d'étudiants potentiels d'autres régions du
Québec. L'Université de Sherbrooke relèvera rapidement ce défi et bientôt,
son rayonnement dépassera largement les frontières du pays.
Les premiers balbutiements du recrutement
Durant la décennie 1960, le recrutement était souvent pris en charge
par les professeurs. Jean-Marc Lalancette était alors jeune professeur de
chimie : «Chaque printemps, je partais avec des collègues pour faire une
grande tournée. J'ai sûrement usé une ou deux voitures à sillonner les
routes crevassées du Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi. Mais l'effort en
valait la peine, puisque plusieurs étudiants n'auraient pas connu
l'Université autrement. Ainsi, plusieurs jeunes gens ont choisi de
contourner Montréal et Québec pour venir étudier à Sherbrooke»,
raconte-t-il.
L'Université à l'ère des communications
En 1961, l'Université a trouvé un moyen ingénieux de rejoindre le grand
public. Alors que des cours étaient déjà proposés à la radio, l'Université
a poussé la démarche un cran plus loin en présentant des cours télévisés,
à la station CHLT-TV ainsi qu'à Radio-Canada. Il ne s'agissait pas d'une
nouveauté – l'Université de Montréal présentait aussi des cours.
Cependant, ce créneau constituait une vitrine enviable pour une jeune
université. En 1964, certains cours télévisés de l'Université rejoignaient
près de 20 000 foyers, alors que quelques centaines d'étudiants étaient
inscrits à ces cours.
Les services hors campus
Dès sa fondation, l'Université offrait des cours du soir destinés à une
clientèle adulte. Au début des années 1970, elle prend les moyens de
rejoindre de nouvelles clientèles en offrant des cours dans des écoles de
Victoriaville et Thetford Mines, notamment. En 1972, l'Université
s'implante d'une manière plus solide à Granby : la Direction générale de
l'éducation permanente ouvre un centre d'enseignement aux adultes où sont
offerts surtout des cours en éducation et en administration. Le succès du
centre de Granby semble être la prémisse à une prochaine étape majeure de
développement pour l'Université qui surviendra une quinzaine d'années plus
tard. À l'automne 1989, le Centre de services de l'Université de
Sherbrooke en Montérégie ouvre ses portes à Longueuil. Des cadres en
exercice viennent s'y perfectionner en s'inscrivant à la maîtrise en
administration des affaires.
Un rayonnement outre-frontière
Plusieurs initiatives ont aussi valu à l'Université une reconnaissance
à l'étranger. Parfois ce sont les travaux de certains chercheurs qui
contribuent à faire connaître l'institution. De plus, certains organismes
issus des facultés joueront un rôle actif sur la scène internationale.
C'est le cas notamment de l'Institut de recherche et d'enseignement sur
les coopératives (IRECUS), né en 1975 de la fusion de deux autres
organismes voués à promouvoir l'étude des coopératives dans les pays en
voie de développement d'Afrique francophone. Les équipes du Centre de
recherche en télédétection mis en place dans les années 1980 mèneront
aussi divers travaux à l'étranger.
|

Alain Royer, Patrick Cliche et Norman McNeill
fournissent des données à la NASA,
en employant ce photomètre solaire, en 1996.
|

Deux professeurs participent à un événement
de recrutement à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1967.
Le stand annonce l'ouverture prochaine du futur pavillon des sciences
appliquées, aujourd'hui la Faculté de génie. |
|

La télévision constitue pour l'Université
un moyen idéal de rejoindre la communauté
estrienne dans les années 1960. Ici, le doyen
de la Faculté de médecine Gérard-Ludger
Larouche, le recteur Irénée Pinard et
Paul Chevalier participent à une émission
de CHLT-TV, lors de l'annonce de la création
de la Faculté de médecine en février 1961.
|

En janvier 1991 au Maroc, le professeur de géographie
et télédétection Hugh Gwyn mène des travaux en
compagnie de Filali Fadel Abdel Fatah et Lhoucine
Serraou, de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.
|
|

Une délégation de visiteurs éthiopiens
rencontre le professeur Ferdinand Bonn en 1991.
|
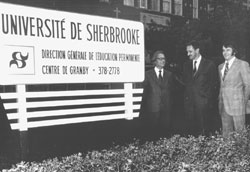
En septembre 1972, la Direction générale
de l'éducation permanente ouvre à Granby
un centre d'enseignement aux adultes où sont offerts
surtout des cours en éducation et en administration.
|
Retour à la une
|